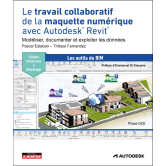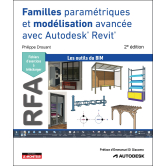Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes, qui n’ont malheureusement pas été pensées pour faire face au dérèglement climatique. En conséquence, de nombreuses villes européennes s'efforcent aujourd’hui de lutter contre des phénomènes d'îlots de chaleur urbains (des pics de températures en milieu urbain plus importants qu’en zones rurales ou forestières voisines) de plus en plus fréquents. Le phénomène s’explique par les surfaces minéralisées des villes qui stockent la chaleur.
Les variations de température peuvent être importantes ; par exemple à Londres, on constate des différences de 10 °C entre le centre de la ville et ses alentours. Le récent dôme de chaleur en Amérique du Nord est un autre triste exemple de ces phénomènes climatiques extrêmes. En période chaude ou caniculaire, les municipalités sont désormais contraintes de prendre des mesures pour protéger leurs habitants en les orientant par exemple vers des "oasis de fraîcheur" telles que les parcs, les piscines ou même les musées.
La ville de Paris a notamment développé l'application Extrema Paris permettant de repérer en temps réel les lieux frais à proximité. Autre exemple, la municipalité de Barcelone a décidé de couvrir 30 % des espaces fréquentés par des arbres dans le but de réduire les pics de chaleur.
Un nouvel indice dédié au climat thermique
Les microclimats des villes et la façon dont la population y évolue, doivent désormais faire l’objet d’une analyse et d’une gestion préventives plus fines car même une température de 20 °C peut rapidement se transformer en 25 °C ressenti en fonction de l’orientation du soleil, du vent et de l'humidité. Afin de déterminer les conditions climatiques permettant le confort thermique du corps humain, l’indice universel du climat thermique (Universal Thermal Climate Index, UTCI) a été créé par la Société internationale de biométéorologie en 2009. Combiné avec des données météorologiques et des simulations de la quantité de chaleur renvoyée par les bâtiments, il est désormais possible de prédire le risque d'îlots de chaleur et d’aménager de nouvelles zones en conséquence.
Le calcul de l’UTCI combiné aux données de projets urbains n’est qu'un exemple parmi tant d’autres pour aider à bâtir des villes plus durables grâce à l'analyse avancée de données. Tout aussi délicats à appréhender, les eaux pluviales et les inondations sont également des défis auxquels les villes du monde entier sont de plus en plus souvent confrontées. Ici encore, l'analyse, la simulation et la visualisation des données permettent de prendre les décisions les plus judicieuses et durables pour les générations futures.
Processus séquentiel et laborieux
Cependant, l’aménagement du territoire et des villes implique de nombreux acteurs avec chacun leurs propres référentiels. Face à un jeu de contraintes toujours plus grand, bâtir la ville durable de demain devient de plus en plus complexe, et le besoin de méthodes de travail plus agiles se fait sentir par l’ensemble des acteurs. La planification des projets urbains est aujourd’hui le plus souvent un processus séquentiel et laborieux, réunissant des acteurs travaillant en silos et partageant difficilement l’information.. Toute modification du cahier des charges (par exemple pour intégrer une nouvelle norme de développement durable) génère de nombreux retards voire met en danger la réalisation d’un projet (ou à l’inverse, la norme n’est pas prise en compte pour ne pas porter atteinte au projet ce qui ne peut constituer une solution durable).
Visualisation lors des études d'avant-projet
Il est donc temps d’entamer une réflexion sur les méthodes et techniques qui ont fait leurs preuves dans d'autres industries et de discuter ouvertement de la manière dont elles pourraient améliorer la qualité et la durabilité des projets urbains, ainsi que leurs délais et leurs coûts. C’est par exemple l'objectif du projet Digigrow en Suède : ce projet, dédié à la normalisation et à la gestion du cycle de vie dans le secteur du bâtiment, a permis aux municipalités participantes (équivalentes de nos aménageurs) de tester différents outils et méthodes pour les aider à mener à bien des travaux complexes, tout en désilotant les métiers et en rendant la culture d’entreprise plus encline au changement.
Digigrow a notamment révélé l'importance de visualiser et de simuler diverses options de conception pour que chaque métier puisse facilement aboutir à des solutions optimales. Le rapport final du projet pointe les avantages d'outils de visualisation aux stades d’étude d’avant-projet. Il note également que la comparaison de plusieurs propositions en amont d’un projet réduisait les coûts et les délais lors des phases suivantes, et que le processus était beaucoup plus efficace lorsque davantage d’équipes pouvaient visualiser les avancées d’un projet et interagir en temps réel.
Les outils numériques nous offrent une magnifique chance de repenser nos méthodes de travail pour bâtir des villes plus durables. Ces outils existent, il suffit que plus de professionnels s’y intéressent et s’en emparent pour révolutionner la conception des projets urbains !