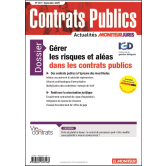Depuis le 1 janvier 2010, une nouvelle étape a été franchie vers le tout numérique puisque désormais acheteurs et opérateurs sont soumis à de nouvelles obligations. Mais, si l’, complété par l’arrêté du 14 décembre 2009, a posé le principe de la dématérialisation dans la procédure de passation des marchés publics, les communications et échanges par voie électronique n’ont pas eu à ce jour le succès escompté. Le « Guide pratique de la dématérialisation des marchés publics » désormais disponible devrait les relancer grâce à son approche pratique et pédagogique des différentes étapes de la vie d’un marché public, depuis la publicité jusqu’à l’archivage.
Publicité
Pour les marchés inférieurs à 90 000 euros HT, bien qu’il n’existe aucune obligation de mettre en ligne les avis d’appel public à concurrence (AAPC) sur le profil d’acheteur (PA), les acheteurs y trouveront un intérêt pour élargir la diffusion de l’information à condition préalablement de s’enquérir que le dit profil jouisse d’une audience suffisamment large auprès des opérateurs économiques.
Pour les marchés supérieurs au seuil de 90 000 euros HT, l’AAPC doit :
- contenir certaines informations obligatoires parmi lesquelles l’adresse de téléchargement, les exigences de l’acheteur quant aux modalités de transmission des candidatures et des offres, l’adresse physique ou électronique du service auprès duquel il est possible d’obtenir la version papier ou sur support électronique des éléments du dossier de consultation des entreprises estimés volumineux ou confidentiels ;
- être strictement identique dans son contenu s’il est publié dans plusieurs supports ;
- être publié sur le PA après l’envoi aux organes officiels.
Dossier de consultation des entreprises
Le dossier de consultation des entreprises (DCE), défini comme étant l’ensemble des documents et informations préparées par l’acheteur pour définir l’objet, les caractéristiques et les conditions d’exécution du marché, est placé obligatoirement sur le PA pour les marchés supérieurs à 90 000 euros HT, avec un accès libre, direct et complet dans un format d’usage fréquent très largement accessible pour les opérateurs économiques. Et si certains éléments apparaissent au pouvoir adjudicateur comme étant volumineux, voire confidentiels ou sensibles, il est possible d’organiser une diffusion sous une forme papier ou sur support physique électronique en l’indiquant dans le règlement de consultation (RC).
Enfin, et contrairement à une idée répandue, ce DCE ne requiert pas de signature électronique, pas plus qu’une signature manuscrite de la part de l’acheteur. Concernant les modalités de consultation et de téléchargement par l’entreprise, dès que l’acheteur public décide de placer le DCE à la disposition des entreprises sur son PA, il doit préciser l’adresse de téléchargement dans l’AAPC, avec notamment un lien direct vers ce DCE.
Depuis le 1 janvier 2010 et l’arrêté en date du 14 décembre 2009, les entreprises ont désormais la possibilité de télécharger les documents de la consultation sans fournir à la personne publique d’informations relatives à leur identification. Pour autant et en pratique, il est de leur intérêt d’indiquer le nom de la personne physique chargée du téléchargement voire l’adresse électronique afin que puissent lui être communiquées les éventuelles modifications ou précisions apportées au dossier par l’acheteur.
En tout état de cause, l’entreprise dispose toujours :
- de la faculté de solliciter les documents de la consultation sur support papier alors même que ces derniers sont mis en ligne ;
- et de la faculté d’adresser sa candidature et son offre sur support papier alors même qu’elle a précédemment obtenu lesdits documents par voie électronique.
Depuis le 1 janvier 2010, les entreprises ne jouissent plus d’une totale liberté quant au choix du mode de transmission, car si la personne publique exige une transmission par voie électronique, elles n’auront d’autre choix que de s’y soumettre, sous peine de rejet de leur dossier. Si l’entreprise a opté pour un envoi dématérialisé, alors elle devra le faire pour l’ensemble des documents de la procédure. Il lui est impossible de transmettre successivement sa candidature sur support papier puis son offre dématérialisée.
Présentation et examen des candidatures et offres
La présentation des candidatures et des offres se fait sous forme d’enveloppes virtuelles contenant des fichiers électroniques qui peuvent être nommés si le RC le prévoit pour en faciliter le traitement.
Le mode dématérialisé ne change en tout état de cause rien sur l’obligation pour l’entreprise d’y faire figurer toutes les pièces exigées par l’acheteur public. Quant à leur examen, il est soumis d’une part aux mêmes règles que celles applicables sur support papier et n’autorise pas la réunion d’une CAO respectivement pour l’examen d’un dossier sur support physique et l’examen d’un dossier dématérialisé. Il implique nécessairement, d’autre part, que la personne physique issue de la collectivité soit habilitée et dispose de la clé de déchiffrement.
En outre, il appartient à l’acheteur de vérifier la validité de la signature tant des pièces relatives à la candidature que des pièces relatives à l’offre et notamment de l’acte d’engagement. Cet examen dématérialisé imposera à n’en pas douter des fortes adaptations pour les CAO qui devront gérer simultanément dossiers sur support papier et dossiers dématérialisés.
L’achèvement de la procédure n’échappe bien évidemment pas à la possibilité pour l’acheteur d’informer les candidats non retenus, de signer l’offre et de notifier le marché au titulaire par voie électronique. Mais l’acheteur dispose de la faculté de poursuivre la procédure en rematérialisant les documents afin de les faire signer de manière manuscrite.
Sécurité
Internet ne présentant pas le même degré natif de sécurité que le support papier, l’acheteur doit recourir à des mesures de sécurisation afin que la procédure dématérialisée atteigne le même niveau de sécurité que la procédure sur support papier. Deux caractéristiques doivent donc exister. La première réside dans l’accès non discriminatoire au profil d’acheteur. Les moyens de transmission des documents et des informations choisis par le pouvoir adjudicateur doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l’accès des candidats à la procédure d’attribution.
La seconde caractéristique réside dans le degré de sécurisation du profil d’acheteur dont la responsabilité incombe au pouvoir adjudicateur qui assure la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire. Les règles de sécurité des moyens utilisés pour assurer la conservation et la confidentialité des dossiers électroniques transmis sont alors de deux ordres :
- la sécurité des transactions est principalement obtenue par l’utilisation d’un réseau sécurisé (le « profil d’acheteur ») sans discrimination d’accès ;
- la confidentialité entendue dans son sens habituel : la conservation du secret sur les dossiers de candidature et d’offres assurée par leur chiffrement ainsi que par l’emploi de coffres-forts électroniques .
Profil d’acheteur
Pour les marchés supérieurs à 90 000 euros HT, l’acheteur public doit publier systématiquement sur son profil d’acheteur (PA) l’avis d’appel public à concurrence (AAPC) et le dossier de consultation des entreprises (DCE), étant entendu que le PA, généralement une plate-forme, ne s’apparente pas au simple site Internet de ce dernier mais doit offrir :
- d’une part, toutes les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des procédures avec, au minimum, une mise en ligne des AAPC et du DCE, une réception des candidatures et des offres de manière sécurisée et confidentielle ;
- d’autre part, un accès libre, direct et complet notamment aux personnes handicapées à l’échéance du 14 mai 2011 pour l’Etat, et du 14 mai 2012 pour les collectivités locales en application de la sur l’égalité des droits et des chances (décret d’application du 14 mai 2009).
Rien n’interdit au pouvoir adjudicateur d’imposer la dématérialisation des réponses par voie électronique pour les marchés inférieurs au seuil précité, étant entendu que l’usage du PA est, d’ores et déjà, rendu obligatoire pour les achats de fournitures ou de services informatiques d’un montant supérieur à 90 000 euros HT.
Enfin - et à compter du 1 janvier 2012 -, le pouvoir adjudicateur ne pourra plus, en principe, refuser de recevoir les candidatures et les offres transmises par voie électronique pour les achats de fournitures de services ou de travaux supérieures à 90 000 euros HT.
Horodatage et copie de sauvegarde
Les candidatures et les offres sont transmises par tout moyen donnant date certaine. L’arrêté en date du 14 décembre 2009 stipule que le dépôt des candidatures et des offres transmis par voie électronique ou sur support physique électronique donne lieu à « un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception ».
Une particularité des marchés publics dématérialisés réside dans la possibilité pour les entreprises d’avoir recours à une « copie de sauvegarde » dont l’objectif est de remédier aux aléas de la technique, comme :
- la présence d’un « programme informatique malveillant » (virus, cheval de Troyes...) dans la réponse principale ;
- une réponse électronique parvenue hors délai ou impossible à ouvrir ou illisible (si la copie est reçue dans les délais) ;
Cette copie de sauvegarde sur support papier ou sur support physique électronique s’emploie parallèlement à la voie électronique, et ce en respectant le même délai. Se pose ici la question de l’impossibilité par le pouvoir adjudicateur de lire le document dès lors que son système informatique est défaillant.
Signature électronique
La signature électronique qui exige des garanties permet d’identifier le signataire et manifeste son consentement au document signé.
Elle incombe aux candidats et au pouvoir adjudicateur.
La signature électronique est requise pour les réponses des candidats et elle ne concerne pas le seul dossier électronique mais bien chacune des pièces le composant pour autant que la signature est exigée sur l’original.
L’article 48-I du CMP stipule en effet que « les offres sont présentées sous la forme de l’acte d’engagement [du candidat]. Lorsqu’elles sont transmises par voie électronique, la signature de l’acte d’engagement est présentée selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l’Economie ». L’acte d’engagement signé électroniquement et imprimé sur support papier n’a donc qu’une valeur de copie.
Par ailleurs, l’article 5 de l’arrêté d’application de 2006 dispose que « les candidatures et les actes d’engagement, transmis par voie électronique ou envoyés sur support physique électronique, sont signés par l’opérateur économique au moyen d’un certificat de signature électronique, qui garantit notamment l’identification du candidat ». N’importe quel certificat du marché ne peut pas faire l’affaire. Et seuls ceux conformes à un référentiel intersectoriel de sécurité et référencés sur une liste établie par le ministre chargé de la Réforme de l’Etat peuvent être utilisés. Les entreprises doivent donc être vigilantes.
La passation d’un marché comporte de nombreuses décisions du pouvoir adjudicateur portées par autant de documents papier signés. Depuis l’ et son article 8, il est entendu que « les actes des autorités administratives peuvent faire l’objet d’une signature électronique », qui devra être apposée par « l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité (...) qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l’acte auquel elle s’attache et assure l’intégrité de cet acte ».
Un dispositif proche de celui de l’. Bon nombre de collectivités affichent un retard sur cette thématique.
Archivage
Les documents relatifs aux marchés publics doivent pouvoir être conservés. Ainsi, les pièces des candidatures retenues et les pièces de l’offre ouvertes mais non retenues doivent l’être pendant cinq ans. Pour ce qui est des candidats et offres retenues, la durée est de dix ans pour les marchés de services et de fournitures et, au-delà, pour les marchés de travaux qui peuvent faire l’objet de contentieux de nature décennale.
Quelques regrets
Si le guide apparaît comme un excellent instrument pédagogique à destination des acheteurs et des entreprises, on peut regretter qu’il n’aborde que partiellement les problèmes de la multiplicité des profils d’acheteurs et la problématique des bordereaux des prix unitaires à ressaisir.