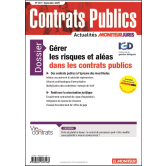L’innovation constitue l’un des axes majeurs de la réforme de la commande publique entrée en vigueur le 1er avril 2016. Le 15 avril, devant un parterre d’acteurs de la commande publique réunis à Bercy, le ministre de l’Economie lui-même l’a une nouvelle fois revendiqué. « L’innovation est un objectif de notre politique économique. Elle est au centre de cette réforme de la commande publique. Le caractère innovant d’une offre est devenu un critère d’attribution. Je serai vigilant pour que, par l’application de ce critère d’innovation, on puisse faire vivre les innovations françaises et les PME qui portent ces innovations », a soutenu Emmanuel Macron.
Pour le ministre de l’Economie, l’achat public est structurant, il doit donc être mis au service du développement de certains secteurs, par exemple du bâtiment. L’ et le sur les marchés publics offrent désormais une palette d’outils au service de cette innovation. A commencer, donc, par la consécration du critère d’innovation.
Critère d’attribution et conditions d’exécution.
En cas de recours à plusieurs critères pour l’attribution d’un marché public, l’acheteur public peut se fonder sur le « caractère innovant » d’une offre pour départager les propositions (article 62 du décret).
Par ailleurs, l’ordonnance du 23 juillet 2015 autorise, par son article 38, à introduire, dans les conditions d’exécution d’un marché public, la prise en compte de considérations relatives à l’innovation, à condition qu’elles soient liées à l’objet du marché public. En outre, pour bien des praticiens, l’évaluation de la performance des opérateurs, de la réalisation des prestations après coup permet de contrôler et de comptabiliser la performance et les gains dus à une innovation.
Examen des offres.
La possibilité, désormais autorisée, d’examiner les offres avant les candidatures (art. 68 du décret) permet, quant à elle, de ne pas écarter d’entrée des propositions innovantes qui n’auraient pas passé le stade de la candidature.
Procédure concurrentielle avec négociation et dialogue compétitif.
L’article 25 du décret marchés publics autorise, lui, le recours, par les pouvoirs adjudicateurs, à la procédure concurrentielle avec négociation et au dialogue compétitif en procédure formalisée (marchés supérieurs aux seuils européens, soit 5,225 millions d’euros HT en travaux) notamment « lorsque le besoin consiste en une solution innovante ».
C’est à ce moment-là que le décret définit ce que la réforme entend par travaux, fournitures ou services innovants : ceux-ci doivent être « nouveaux ou sensiblement améliorés ». Le caractère innovant est entendu comme pouvant « consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ». Le périmètre semble assez large pour englober nombre de cas de figure… L’élargissement des conditions de recours à la négociation et au dialogue compétitif pourrait donc avoir pour effet d’encourager les démarches d’innovation, les échanges étant facilités entre acheteurs et opérateurs économiques.
Sourçage.
Le gouvernement mise d’ailleurs également beaucoup sur la technique du sourçage pour développer l’innovation (art. 4 du décret). Les « études et échanges préalables » en amont des consultations, selon la dénomination officielle, l’information des opérateurs économiques de futurs projets doivent permettre aux acheteurs de mieux connaître les solutions disponibles sur le marché, espère Bercy. Ceux-ci « disposeront alors d’une connaissance plus approfondie des solutions techniques existantes et notamment des innovations », indique le ministère dans sa présentation de la réforme de la commande publique 2016.
Définition des besoins.
Autre phase de préparation des marchés au service de l’innovation mise en avant par le ministère de l’Economie : la définition des besoins. Via les spécifications fonctionnelles, l’acheteur pourra formuler ses besoins en termes de performance « sans préjuger des solutions techniques », soutient Bercy. Cette définition préalable des besoins est en effet effectuée par référence à des spécifications techniques (art. 31 de l’ordonnance marchés publics). Celles-ci peuvent être formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles (art. 6 du décret marchés publics).
Variantes.
Autoriser les variantes, ou même les imposer (art. 58 du décret), permet également aux opérateurs économiques de faire remonter idées et techniques nouvelles ou propres aux entreprises que l’acheteur n’avait pas envisagées.
Partenariat d’innovation.
Le partenariat d’innovation constitue, quant à lui, la grande nouveauté contractuelle pour susciter l’innovation par le biais des marchés publics. Il est directement issu des directives européennes et a été l’un des premiers outils transposés en 2014 par le décret du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics. Il a été repris dans la réforme 2016 par les articles 93 et suivants du décret du 25 mars 2016.
Emmanuel Macron le qualifie de « partenariat de long terme ». Cet outil constitue un levier pour la recherche et le développement, sans remise en concurrence à chaque étape du processus, depuis la réflexion sur une innovation jusqu’à son éventuelle acquisition par la personne publique cocontractante. « Il donne de la visibilité aux acteurs économiques, ce qui est très important », souligne le ministre de l’Economie.
Mais il n’est pas l’outil le plus simple à utiliser et se limite à des projets particuliers avec un besoin de R & D. Depuis septembre 2014, les opérations lancées en partenariat d’innovation restent assez rares : armoires électriques pour mieux appréhender le risque sismique (CNRS), TGV du futur (SNCF), construction d’un bâtiment avec l’appui d’une imprimante 3D (ancienne région Nord-Pas-de-Calais) figurent parmi elles.
Contrats globaux.
Associer les concepteurs dans les contrats globaux demeure une autre voie, a également relevé Catherine Jacquot, présidente du conseil national de l’Ordre des architectes, lors de la conférence de Bercy du 15 avril. « Renforcer le rôle de la maîtrise d’œuvre dans ces contrats peut par exemple permettre l’innovation », a-t-elle plaidé. Dans une logique de réemploi des matériaux, de lutte contre les déchets du BTP, Marie-Hélène Borie, directrice du patrimoine et de l’architecture à la Ville de Paris, a pour sa part cité les marchés globaux de performance (art. 34 de l’ordonnance marchés publics et art. 92 de son décret) aux conditions de recours élargies. « Nous allons continuer à être hypercréatifs et répondre à la volonté des élus en arrêtant de jeter les vieux bâtiments pour faire du neuf ! Les marchés globaux de performance vont nous permettre de réellement coconstruire car ils autorisent le dialogue, les discussions entre maître d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, y compris pour la rénovation partielle de bâtiments ! Nous espérons aussi qu’ils tiendront pour les bâtiments neufs… » (le Parlement a la possibilité de revenir prochainement sur ces dispositions par le biais de plusieurs textes, NDLR).
D’autres contrats plus complexes comme les marchés de partenariat, mais aussi les concessions, dans lesquels le partenaire privé est soumis à des conditions très contraintes de délais, de remise d’ouvrages ou autres, notamment lorsque l’exploitation et la maintenance sont associées, demeurent également des outils susceptibles de pousser le cocontractant à davantage d’inventivité. C’est ce que les économistes appellent « la puissance des incitations dans les contrats globaux ». « Le regroupement des activités nécessaires à la réalisation d’un projet en un seul contrat incite l’opérateur à innover de manière à générer plus de recettes », peut-on ainsi lire dans l’ouvrage « Economie des partenariats public-privé », publié en 2015 sous la direction de Stéphane Saussier, aux éditions De Boeck.
Innovations contractuelles.
La réforme de la commande publique 2016 ouvre enfin la voie à l’innovation contractuelle. L’ordonnance concessions du 29 janvier 2016 apporte de nouvelles perspectives, allant au-delà du service public et des travaux. La combinaison de cet outil, des marchés publics et des entreprises publiques locales, par exemple à travers la Semop, « ouvre des possibilités contractuelles qu’il est difficile aujourd’hui d’apprécier », confiait, il y a peu au « Moniteur », Alexandre Vigoureux, responsable du département juridique de la Fédération des EPL.