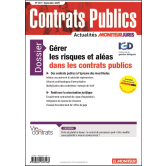Simplifier et améliorer les règles d’utilisation du sol. Voilà toute l’ambition de la loi Elan en matière d’urbanisme : de la planification aux règles régissant les autorisations de construire en passant par la loi Littoral et le traitement du contentieux, des pans entiers du Code de l’urbanisme sont ainsi revisités.
Des documents d’urbanisme modernisés
Du côté des documents d’urbanisme tout d'abord, le texte met définitivement un terme à l’applicabilité d’un ancien plan d’occupation des sols (POS) « ressuscité » en cas d’annulation d’un plan local d’urbanisme (PLU). Le texte précise en effet que le POS redevient applicable pendant une durée de deux ans à compter de l’annulation et qu’il ne « peut faire l’objet d’aucune procédure d’évolution pendant cette période ». Jusqu’à présent, ces documents pouvaient être révisés pendant ces deux années. Au terme de cette période, si la commune ou l’interco ne s’est toujours pas dotée de PLU ou de carte communale, c’est le règlement national d’urbanisme qui s’applique.
Autre mesure de planification : dans le cadre de l’élaboration des PLU intercommunaux (PLUI), le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui doit se tenir au sein des conseils municipaux des communes membres « est réputé tenu s’il n’a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l’examen du projet de PLU ». Ce nouvel alinéa à l’article L. 153-12 du Code de l’urbanismevise à permettre aux communes non intéressées par la tenue d’un tel débat de s’abstenir sans pour autant ralentir la procédure d’élaboration du PLUI.
Des constructions facilitées
Le texte facilite en outre les constructions dans les zones agricoles et forestières des PLU notamment, lorsque les bâtiments sont « nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ». Pour ces constructions, l’autorisation d’urbanisme sera toutefois soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Et les cartes communales ne sont pas en reste non plus puisque l’article L. 161-4 du C. urb. est totalement réécrit pour permettre à ces documents de préciser et d’étendre la liste des constructions et installations pouvant être admises à titre dérogatoire.
Enfin, dernière mesure relative aux documents d'urbanisme : le gouvernement est autorisé à légiférer par ordonnances, notamment « pour limiter et simplifier, à compter du 1er avril 2021 », les obligations d’opposabilité. Objectif : réduire le nombre de documents d'urbanisme opposables et supprimer le lien de « prise en compte » pour ne conserver qu’un seul lien d’opposabilité : la « compatibilité ».
La loi Littoral assouplie
Après des débats houleux entre parlementaires, le texte issu de la CMP confirme bien l’élargissement des possibilités de construction en zone littorale, « pour les installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines [conchyliculture, mytiliculture et ostréiculture] » et aux ouvrages nécessaires à la production d’énergies renouvelables sur les petites îles. Ces constructions nécessiteront l’accord du préfet et seront soumises à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Les « hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » ont en outre été retirés des dérogations possibles à l’extension de l’urbanisation (nouvel art. L. 121-8 du C. urb.).
Autre nouveauté : le rôle des schémas de cohérence territoriale (Scot). Les modalités d’application de la loi Littoral seront désormais précisées par ces documents. Les Scot détermineront en effet « les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés […] et en défini[ron]t la localisation ».
Feu vert donné au comblement des « dents creuses »
Par ailleurs, dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par un Scot et délimités par les PLU, le projet de loi donne le feu vert au comblement des « dents creuses » : le texte autorise en effet les constructions, en dehors de la bande littorale de 100 mètres, des espaces proches du rivage et des rives de plans d’eau, « à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logements ou d’hébergement et d’implantation des services publics ». Ces constructions ne doivent toutefois pas avoir « pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti ». Les autorisations d’urbanisme seront là encore soumises à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. En cas d’atteinte à l’environnement ou aux paysages, la construction sera refusée.
Et pour faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, les collectivités pourront recourir à la procédure de modification simplifiée des Scot et des PLU. Le recours à cette procédure peu contraignante ne sera possible que jusqu’au 31 décembre 2021 et devra faire l’objet d’une consultation pour avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
En Corse, c’est le plan d’aménagement et de développement durable (Padduc) qui pourra prévoir le comblement des « dents creuses ». En revanche, le recours à la procédure de modification simplifiée n’est pas prévu dans cette hypothèse.
Les dossiers de demande d’autorisations plus sécurisés
Du côté des permis de construire, le projet de loi limite le nombre des pièces contenues dans les dossiers de demandes. Objectif : sécuriser les pétitionnaires en les assurant que seules les pièces nécessaires à la vérification du respect des règles d’urbanisme leur seront demandées.
Par ailleurs, le texte permet à un porteur de projet de demander plusieurs autorisations pour un même terrain. Dorénavant, il ne sera plus nécessaire pour le pétitionnaire d’obtenir au préalable le retrait de la première autorisation. De surcroît, le dépôt de la nouvelle autorisation n’emportera pas retrait implicite de la précédente autorisation (nouvel art. L. 424-5 du C. urb.).
Enfin, la dématérialisation complète (dépôt des dossiers et instruction) des demandes d’autorisation d’urbanisme devra être effective au 1er janvier 2022 pour les communes de plus de 3500 habitants. Cette nouvelle disposition devrait rassurer les élus. Pour mémoire, aux termes des décrets dits « SVE » du 20 octobre 2016 et du 4 novembre 2016, les collectivités auraient dû, à compter du 8 novembre 2018, être en mesure de recevoir toute demande d’autorisation d’urbanisme par voie électronique. S’élevant contre cette échéance qu’elles estimaient trop précipitée, deux associations d’élus avaient demandé un report de cette obligation à 2022.
Dernière nouveauté de la loi concernant les dossiers d'autorisation de construire : la possibilité pour les collectivités de confier l’instruction des demandes à un ou plusieurs prestataires privés. Les organismes retenus devront offrir des garanties d’impartialité et d’indépendance, et la collectivité restera libre de ne pas suivre leur proposition. A noter que cette mission ne devra pas entraîner de charge financière pour les pétitionnaires.
Vers la fin des recours abusifs
En grande partie issu du rapport remis le 11 janvier dernier à Jacques Mézard par la conseillère d'Etat, Christine Maugüe, le texte modifie plusieurs dispositions législatives du Code de l’urbanisme (art. L. 600-1-2 et suivants) dans la perspective de limiter l’insécurité qui pèse sur les opérations du fait des recours contentieux.
Parmi les mesures les plus emblématiques : la recevabilité, pour une association, à agir contre une autorisation de construire, uniquement si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu « au moins un an » avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Aujourd’hui, il suffit que le dépôt soit réalisé « antérieurement » audit affichage.
Par ailleurs, le projet clarifie les règles relatives à l’appréciation de l’intérêt pour agir des particuliers (art. L. 600-1-2 du C. urb.). Cet article exige du requérant qu’il établisse que « la construction, l’aménagement ou les travaux » soient de nature à « affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien » qu’il détient ou occupe. Or, la notion de « travaux » est source d’ambigüité : elle pourrait en effet être comprise comme visant les travaux de chantier, ce qui ne reflète pas l’esprit du texte. Le projet de loi remplace donc à l’article L. 600-1-2, les termes de « travaux » par « projet autorisé ».
Le texte aménage en outre la procédure actuelle de référé-suspension dirigé contre une autorisation de construire : d’une part, la condition d’urgence – nécessaire pour intenter un référé-suspension – est ici présumée satisfaite dès l’octroi de l’autorisation et d’autre part, le référé-suspension est limité dans le temps, « jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort ». Quant à la proposition du rapport Maugüe d’imposer au requérant dont le référé-suspension est rejeté, de confirmer, à peine de désistement d’office, le maintien du recours au fond, elle a été reprise au niveau réglementaire par le décret du 17 juillet 2018 portant modification du Code de justice administrative et du Code de l’urbanisme.
Des autorisations existantes consolidées
Pour renforcer les autorisations, le projet de loi impose aux juges de prononcer l’annulation partielle ou le sursis à statuer et corrélativement, de motiver le refus de prendre une telle mesure. Rappelons qu’aujourd’hui, il ne s’agit que d’une faculté offerte aux magistrats (art. L. 600-5 du C. urb.).
En outre, un permis modificatif ne pourra plus être contesté que dans le cadre de l’instance contre le permis initial. Cette mesure vise à éviter les recours en cascade, qui prolongent l’incertitude pour le bénéficiaire de l’autorisation.
Par ailleurs, l’article L. 600-7 du C. urb. concernant l’action en responsabilité contre les recours abusifs est modifié afin de faciliter le prononcé de condamnations pécuniaires, aujourd'hui très rares. Et quant aux transactions financières visant à obtenir un désistement en cas de recours (art. L. 600-8 C. urb.), elles sont interdites pour les associations. Il s’agit à travers cette mesure de dissuader ces dernières de marchander leur désistement.
Autre mesure prévue : la limitation de la répercussion de l’illégalité d’un document d’urbanisme sur les autorisations de construire délivrées avant le prononcé de l’annulation, « dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet » (nouvel art. L. 600-12-1 C. urb.).
Enfin, le projet de loi lève l’incertitude quant à d’éventuelles poursuites pénales dirigées contre des constructeurs de bonne foi en cas d’exécution de travaux conformes à un permis définitif après annulation d’un PLU.
Retrouvez les décryptages des autres volets de la loi Elan en cliquant ici