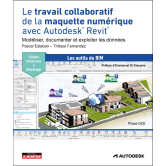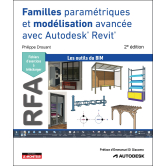Les blocs de béton formant les parapets et les corniches des cinq ponts de l'autoroute A35, dans le département du Haut-Rhin, ne connaîtront pas la longévité des modèles dont ils s'inspirent, à savoir les remparts des châteaux forts alsaciens. Moins d'un quart de siècle après leur mise en service, ces ouvrages ont montré des signes d'effritement qui n'ont pas échappé à la vigilance de la cellule d'exploitation de la direction départementale de l'Equipement (DDE).
Cinq ans après avoir détecté la pathologie, la subdivision de Rixheim a traité, l'an dernier, les deux ponts les plus malades. Trois autres ouvrages feront l'objet d'un traitement similaire cette année.
Des diagnostics mémorisés
La détection précoce de la pathologie doit beaucoup à « Edouart », la banque de données des ouvrages d'art de l'Etat. Sa mise en service, en 1994, a coïncidé avec une rationalisation de la maintenance de ce patrimoine. Cette politique s'est traduite par la systématisation des visites, dites Iqoa (image et qualité des ouvrages d'art).
Conformément à la procédure nationale, les quatorze subdivisions départementales de l'Equipement, qui exploitent 500 ouvrages de plus de 2 m d'ouverture, ont classé les visites en trois catégories : à raison d'une heure par auscultation, les visites annuelles permettent de détecter d'éventuelles anomalies ; une fois tous les trois ans, les visites Iqoa, effectuées par la cellule départementale du service d'exploitation des routes et des transports, permettent d'établir en quatre heures des diagnostics approfondis ; si le besoin s'en fait sentir, une telle visite peut déclencher l'intervention d'un laboratoire spécialisé. La mémorisation de ces procédures par Edouart permet d'intégrer le traitement des désordres dans la programmation triennale glissante du ministère de l'Equipement.
Dès 1994, cette politique a permis à la DDE de détecter la dégradation des parements extérieurs des ponts de l'A35. « Dans certains cas, l'écaillage avait rendu l'armature visible », témoigne Patrick Vuillemenot, chef de cellule au service de l'exploitation des routes. Dans un premier temps, les interventions des patrouilles hebdomadaires ont consisté à stimuler le processus : « On tape sur ce qui sonne creux pour éviter la chute inopinée du béton », explique Patrick Vuillemenot. En 1996, l'Iqoa révèle une dégradation croissante des ouvrages, jusqu'à l'intérieur des parements. Les techniciens détectent une sensibilité anormale du béton aux cycles gel/dégel, ainsi qu'une porosité du matériau. D'où l'intervention, en 1997, du Laboratoire régional des ponts et chaussées (LRPC) de Strasbourg, qui ajoute au diagnostic le constat d'une mauvaise résistance au sel de déverglaçage. « Sans aboutir à des certitudes, les études soupçonnent un déficit de ciment à la suite d'un changement de formulation du béton », précise Patrick Vuillemenot. Seule nouvelle rassurante : en 1998, une seconde analyse du LRPC conclut à l'absence de problèmes d'ancrage des blocs parapet/corniche dans la structure des ponts.
Pour traiter ces pathologies, la maîtrise d'oeuvre a choisi une solution qui concilie l'économie et l'amélioration de la sécurité. Ce parti sonne le glas des couples monoblocs formant les parapets et les corniches. « La dégradation de l'un de ces éléments n'impliquera plus le changement de l'ensemble », se réjouit Patrick Vuillemenot. L'aluminium, qui se substitue au béton, allégera le poids de l'ouvrage. La scission entre les fonctions de parapet et de corniche a permis à la DDE de modifier les murs d'about pour intégrer aux ponts une glissière de sécurité pour le passage des piétons.
Les corniches désolidarisées des parapets
A Sausheim, l'accélération de la dégradation des ouvrages les plus malades, constatée en 1997 par le LRPC, a amené la DDE à prendre des mesures provisoires, jusqu'à la fin de l'année dernière. Pour éviter que la chute de morceaux de béton ne menace la sécurité de la circulation, la subdivision de Rixheim a cherché à tâtons la solution appropriée : « Pour nous guider, nous ne disposions, ni d'une norme, ni même d'une référence comparable », témoigne Didier Dromard, adjoint au subdivisionnaire. L'administration a finalement fait appel aux compétences des fabricants de filets destinés à la pêche en mer : la Société rhétaise des filets, implantée sur l'île de Ré, a fabriqué les filets en Nylon à double maille. Ce matériau peu ordinaire répond au cahier des charges défini sur la base d'une étude du souffle émis par les camions sous les ponts. La Corderie Vincent, basée à Lyon, a accroché les filets aux ouvrages à l'aide de mousquetons en acier galvanisé, à raison d'un ancrage par mètre. Des systèmes d'ouverture ont permis à la subdivision d'extraire régulièrement les gravats accumulés dans ces filets.
Forte de cette expérience encourageante avec Edouart, la cellule d'exploitation de la DDE du Haut-Rhin attend des résultats comparables grâce à « Muriel ». Dédiée à la maintenance des murs de soutènement, cette nouvelle banque de données du ministère de l'Equipement entre en service dans un climat favorable : l'Administration a eu le temps d'intégrer une culture de l'entretien de son patrimoine.
Le montant des travaux pour les deux premiers ouvrages s'élève à 1,2 million de francs (183 000 euros) et à 2,35 millions de francs (358 000 euros) pour les trois prochains ouvrages (calendrier prévisionnel : second semestre 2000).
Fiche technique
Maître d'ouvrage et maître d'oeuvre : DDE du Haut-Rhin, service d'exploitation des routes et des transports.
Entreprises : Richert (béton) et Clelial (aluminium).
PHOTOS : Avant travaux de réparation, les parements extérieurs sont fissurés et des morceaux de béton des parapets menacent de tomber sur la chaussée inférieure.
Après travaux, l'aluminium se substitue au parapet en béton et allège le poids du pont qui enjambe l'A 35.