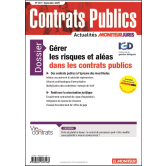De nombreuses dispositions relatives à l'aménagement commercial, pour l'essentiel entrées en vigueur le 1er janvier 2019, sont contenues dans la loi Elan du 23 novembre 2018. Les nouvelles mesures visent principalement à préserver et à revitaliser les centres-villes, notamment dans les 222 communes identifiées par le programme « Action cœur de ville », et à renforcer les procédures et le contrôle administratif dans le but de faire respecter les autorisations délivrées.
Des mesures pour régénérer les centres-villes
Opérations de revitalisation du territoire. Dans un but de mixité sociale, d'innovation et de développement durable, la loi Elan a créé des opérations de revitalisation de territoire (ORT). Ce nouvel outil peut être institué pour mettre en œuvre un projet global destiné à adapter et moderniser les logements, les locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain (). A cette fin, une convention d'ORT conclue entre les acteurs publics et privés définit le projet de revitalisation du territoire concerné, délimite le périmètre des secteurs d'intervention et précise la durée, le calendrier et le plan de financement des actions prévues.
Dispense et suspension d'autorisation. Dans ce cadre, deux dispositifs innovants sont notamment prévus. D'une part, dans les secteurs d'intervention délimités par la convention, les projets commerciaux ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale (AEC), sauf si la convention en décide autrement pour les surfaces de vente supérieures à un seuil qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à 5 000 m² ou 2 500 m² pour les magasins à prédominance alimentaire (). D'autre part, hors secteurs d'intervention et sous certaines conditions, le préfet peut suspendre l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des demandes d'AEC de projets dont l'implantation est prévue sur le territoire des communes signataires de la convention, mais hors des secteurs d'intervention de l'opération. Cette suspension est également possible pour les projets situés sur des communes non-signataires, mais membres de l'EPCI à fiscalité propre signataire de la convention ou d'un EPCI limitrophe ( ). La suspension est d'une durée maximale de trois ans, prorogeable d'un an. Ces nouvelles règles sont d'ores et déjà applicables, dès lors qu'une convention d'ORT est signée.
Des procédures et un contrôle renforcés
Par ailleurs, la loi Elan apporte plusieurs modifications aux projets soumis à AEC. Ainsi, le seuil de surfaces de vente au-delà duquel une autorisation de la CDAC s'impose en cas de réouverture au public d'un magasin de commerce de détail fermé depuis plus de trois ans passe de 1 000 à 2 500 m² ( ). De plus, la loi Elan renforce les contrôles une fois l'autorisation délivrée.
Modification substantielle d'un projet. En outre, un nouvel alinéa inséré à l' clarifie le texte et permet de mieux sécuriser les projets : désormais, une autorisation de modifier substantiellement un projet ne se substitue à la précédente AEC que lorsqu'elle devient définitive et n'est donc plus susceptible d'annulation.
Etude d'impact. Depuis le 1er janvier, le dossier de demande d'AEC doit comporter une étude d'impact réalisée par un organisme indépendant habilité par le préfet. Cette étude évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du territoire concerné ainsi que sur l'emploi. Le pétitionnaire doit en outre démontrer qu'il n'existe aucune friche permettant d'accueillir le projet envisagé (). Cette nouvelle obligation suscite de nombreuses interrogations : eu égard au nombre limité de bureaux d'études spécialisés, quel organisme indépendant sera habilité et sous quelles conditions, quelle incidence sur l'allongement du temps requis pour constituer un dossier ? Il importe que ces organismes soient rapidement désignés, pour que les pétitionnaires n'accumulent pas trop de retard dans leur futur projet.
Les nouvelles mesures visent notamment à faire respecter les autorisations délivrées.
Fonctionnement des commissions. Du côté des CDAC, aux quatre personnalités qualifiées déjà présentes en leur sein, s'ajoutent trois autres représentant le tissu économique ( ). Désignées par les chambres consulaires (commerce et industrie, métier et artisanat, et agriculture), elles ne prennent pas part au vote mais présentent notamment la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu. Par ailleurs, la CDAC doit auditionner la personne chargée d'animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre, l'agence du commerce et les associations de commerçants.
Nouveaux indicateurs. Pour rappel, les commissions saisies d'une demande d'autorisation statuent au vu de trois critères : aménagement du territoire, développement durable et protection du consommateur. Ces critères sont précisés par des indicateurs, dont la liste est complétée : ainsi, les commissions doivent dorénavant tenir compte de la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du territoire, des coûts supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports et des émissions de gaz à effet de serre dans certains cas ( ).
Certificat. Un mois avant l'ouverture du projet, le pétitionnaire communique au préfet, au maire et au représentant de l'EPCI concerné un certificat établi par un organisme indépendant, attestant du respect de l'autorisation délivrée ou de l'avis de la commission d'aménagement commercial. L'absence de certificat dans le délai d'un mois rend illicite l'exploitation des surfaces de vente.
En outre, en cas d'exploitation irrégulière, l'exercice du pouvoir de sanction du préfet devient obligatoire et le délai dans lequel l'exploitant peut régulariser est porté à trois mois. A défaut, la fermeture des surfaces de vente illicites est ordonnée sous astreinte jusqu'à régularisation effective. Un décret doit préciser ces dispositions ( ).
Documents d'urbanisme. Enfin, la loi Elan rend obligatoire le document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC) dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territorial (Scot). Il devra prévoir les conditions d'implantation, le type d'activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux différents secteurs identifiés (art. L. 141-17 du Code de l'urbanisme). De surcroît, il peut définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité dans les centralités urbaines ou fixer les conditions d'implantation des constructions commerciales et logistiques en fonction de divers paramètres. En l'absence de Scot, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme intercommunal doivent comporter les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal et déterminer les conditions d'implantation des équipements qui sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable ().