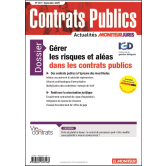A partir d’une enquête portant sur 62 collectivités territoriales, la Cour des comptes a publié mi-septembre un rapport sur l’état des lieux de la mise en œuvre de la politique de protection du patrimoine monumental sous le prisme des collectivités.
L’état des monuments protégés mal connu
Les collectivités sont chargées de la mise en œuvre de la protection du patrimoine monumental soit comme propriétaire, soit au travers de leur compétence d’urbanisme et d’aménageur. Elles sont propriétaires de 45 % des 46 000 monuments historiques, indique le rapport, « soit une proportion supérieure à celles de l’État et des propriétaires privés ». La moitié de ces monuments est située dans des communes de moins de 2 000 habitants. A cette charge s’ajoute l’obligation de préservation des édifices cultuels dont elles sont propriétaires, y compris ceux ne faisant pas l’objet d’une protection au titre des monuments historiques.
Pour intervenir sur ces bâtiments, il faut pouvoir identifier et appréhender son état. Cette connaissance est jugée globalement insuffisante par la Cour des comptes. Pour y remédier, elle recommande « d’ouvrir aux collectivités territoriales l’accès à la base ministérielle “AgrÉgée” qui recense l’état sanitaire des monuments protégés à l’occasion de sa révision en cours ».
Cofinancement indispensable
En outre, cette obligation de conservation est de plus en plus insoutenable sur le plan financier, constate la juridiction financière. En effet, il peut exister un fort déséquilibre entre la taille de la collectivité, sa capacité financière et les services administratifs et techniques dont elle dispose, au regard du nombre de monuments historiques à entretenir. Or les « opérations d’entretien ou de rénovation du patrimoine induisent des coûts structurellement plus élevés que dans l’immobilier traditionnel ». Sont notamment cités le choix des matériaux, le recours à des prestataires experts, mais aussi les délais résultant du contrôle scientifique et technique.
Aussi, « les dépenses d’entretien sont insuffisantes pour éviter une dégradation du patrimoine », alerte la Cour qui indique que le cofinancement public « demeure en l’état actuel indispensable à la conservation du patrimoine monumental ». Il permet également de maîtriser le reste à charge des communes. « Aucun chantier d’envergure n’a pu être engagé par une collectivité sans l’assurance d’obtenir un cofinancement » de l’Etat. Le « reste à charge » moyen représente, pour les communes, 43 % du coût des opérations d’investissement.
A noter que les autorisations d’engagement du programme 175 « Patrimoines », principale source de financement, ont augmenté de manière continue entre 2018 à 2024 pour atteindre 153 M€, mais les communes anticipent une réduction des subventions des régions et des départements.
Mutualisation des coûts et ressources
Pour améliorer la soutenabilité financière, il faut également faire évoluer les modes de pilotage et de gestion. Cela se traduit par la mutualisation des coûts à travers une plus grande anticipation des besoins, une programmation pluriannuelle et une mutualisation des ressources techniques à l’échelle d’un territoire.
Pour cela, la Cour des comptes incite les collectivités à anticiper davantage les avis et prescriptions de l’Etat et relève une « hausse importante des recours contre les avis des architectes des Bâtiments de France (ABF) » qui « atteste d’un manque de dialogue en amont ». Et les invite à s’engager dans une démarche de programmation immobilière patrimoniale avec notamment l’adoption d’un schéma directeur immobilier et la mutualisation des ressources techniques à l’échelle territoriale.
La possibilité de vendre des biens patrimoniaux non utilisés ou dont les coûts d’entretiens sont trop élevés est également évoquée et « ces recettes peuvent être mobilisées pour des opérations de conservation » d’autres monuments.
Simplification des procédures
Le rapport préconise également une accélération de la simplification des règles de procédure pour concilier la protection du patrimoine avec la mission d’aménagement urbain. Les mesures de protection d’un monument historique concernent également ses abords, ainsi que des espaces dont la valeur patrimoniale est reconnue comme « site patrimonial remarquable ». La collectivité doit alors prendre en compte à la fois la protection du patrimoine et ses besoins d’aménagement. Or, un tiers des logements sont situés dans ce périmètre de protection.
Mais les collectivités sont confrontées aux procédures qui se cumulent en matière d’urbanisme et de protection de l’environnement, et sont parfois difficilement conciliables avec les impératifs de transition écologique. Conséquence : « Dans les centres historiques concernés par des règles de protection, le taux de vacance des logements est deux fois plus important qu’ailleurs ».
La mise en œuvre jugée trop lente de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) de 2016, qui avait pour objectif de simplifier les règles de protection et de clarifier les normes, « crée un enchevêtrement particulièrement complexe pour les collectivités » entre les nouvelles et les anciennes règles qui perdurent, relèvent les sages de la rue Cambon.
Ils formulent trois préconisations pour concilier protection et aménagement urbain :
- « accélérer la mise en œuvre de la loi LCAP en organisant en 2026 une concertation sur les procédures de protection avec les associations d’élus concernées » ;
- « examiner d’ici fin 2025 les conditions permettant de modifier le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) sans déclencher automatiquement la révision du plan local d’urbanisme définie à l’article L. 313-1 du Code de l’urbanisme » ;
- renforcer « la formation des élus en matière de réglementation et de gestion du patrimoine monumental à l’issue des prochaines élections municipales ».
Valorisation du patrimoine
Enfin, la valorisation du patrimoine peut également aider à sa conservation. Selon la Cour, cette valorisation peut notamment passer « par l’intégration du patrimoine dans une stratégie économique d’attractivité touristique et de développement local ». Le changement d’usage des édifices cultuels doit aussi être facilité.
Pour rendre efficaces ces démarches de valorisation, elles doivent « s’inscrire dans une stratégie globale portée par les régions en matière d’attractivité du territoire, être en capacité de mobiliser les outils existants en termes d’aménagement et de revitalisation des centres urbains ». Sont ainsi cités les programmes « Action cœur de ville » et « Petites villes de demain ».
Ces démarches de valorisation des monuments historiques, « même au travers de la diversification des offres de service, reste un modèle économique fragile pour les collectivités territoriales, et non exempt de risques juridiques et financiers », conclut le rapport.
Les collectivités territoriales face aux enjeux de leur patrimoine monumental