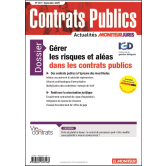L’Agence de l’énergie nucléaire de l’OCDE a publié en juillet le tableau de bord des petits réacteurs nucléaires modulaires (« small modular reactor » - SMR), qui souligne l’intérêt de cette technologie en plein développement. Les SMR apparaissent en effet comme une solution prometteuse et décarbonée, capable de répondre à la croissance des besoins énergétiques, notamment dans le secteur industriel, confronté à l’instabilité des coûts d’approvisionnement.
Data centers. Elle présente également un intérêt tout particulier au regard du développement rapide des centres de données. Il résulte de cette croissance une problématique spécifique d’approvisionnement en énergie électrique, du fait de la corrélation entre l’énergie utilisée par les seuls équipements informatiques et la puissance électrique requise pour la bonne marche des installations (refroidissement, fonctionnement continu, sécurisation, etc. ).
Le développement rapide de data centers de grande taille en France entraîne des besoins importants et localisés, qui peuvent être de l’ordre de 100 à 200 mégawatts (MW) pour un site unique (soit la consommation électrique de villes telles Rouen ou Bordeaux). On comprend, dès lors, que ce secteur soit mis en avant pour justifier la relance du nucléaire. Il se prête particulièrement bien à la technologie des SMR qui se présentent sous la forme de bâtiments modulaires, d’une taille restreinte, implantés sur le site approvisionné afin de l’alimenter, avec des puissances disponibles généralement comprises entre 10 et 300 MWe (pour les SMR de production d’électricité) et entre 20 et 300 MWth (pour ceux de production de chaleur).
Une technologie aux nombreux avantages
Les SMR présentent de nombreux avantages. Les réacteurs, indépendants des réseaux d’électricité ou de chaleur, sont d’une conception standardisée mais qui s’adapte aisément à leur déploiement sur les sites visés. Ils permettent d’assurer une fourniture énergétique fiable, ajustée aux besoins spécifiques de ces infrastructures, tout en répondant aux impératifs de sécurité et de sûreté attendus. Ils se distinguent également par une consommation d’eau bien inférieure aux centrales nucléaires classiques.
France Relance 2030. L’Etat soutient activement le déploiement de cette technologie dans le cadre du plan France Relance 2030. A ce jour, plusieurs opérateurs (Jimmy Energy, Hexana, Nuward [EDF], Newcleo, Calogena, Blue Capsule, etc. ) sont, en France, en phase de développement et d’obtention des autorisations nécessaires.
Un cadre juridique inadapté
L’un des freins importants au déploiement de cette technologie réside dans la relative inadaptation du cadre législatif et réglementaire des « installations nucléaires de base » (INB) qui trouve son siège dans le Code de l’environnement (art. L. et R. 593-1 et suivants C. env. ). Il s’agit en effet d’un dispositif ancien, conçu pour encadrer le développement du programme nucléaire civil français d’initiative publique, principalement les programmes de réacteurs à eau pressurisée (EPR).
Sécurité nucléaire. Ce régime contraignant a été articulé et proportionné aux enjeux majeurs de sécurité nucléaire de ces réacteurs, lesquels recouvrent « la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance ainsi que les actions de sécurité civile en cas d’accident », notamment dans l’objectif de « prévenir les accidents ou d’en limiter les effets et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l’environnement » (art. L. 591-1 C. env.).
Le cadre juridique ainsi élaboré s’applique par défaut aux SMR mais s’avère inadapté à leurs caractéristiques (taille restreinte, modularité, principe de fonctionnement) ainsi qu’au modèle de leur déploiement : les projets de SMR reposent sur une technologie validée conduisant à une construction en usine selon des caractéristiques standardisées, aux fins d’une installation sur les sites d’accueil.
A ce jour, les spécificités du régime des INB expliquent en partie l’hésitation des industriels à se doter d’un SMR pour leurs besoins énergétiques en France, et donc la réticence des investisseurs face aux acteurs français du secteur.
Autorisation de création. Schématiquement, le déploiement d’une INB nécessite de déposer une première demande d’autorisation de création qui doit être accordée par décret (art. L. 593-7 et R. 593-27 C. env.). La demande est présentée par l’exploitant pour une localisation précise. Elle comporte une étude d’impact, une version préliminaire du rapport de sûreté et une étude de maîtrise des risques. Le délai d’instruction est de trois ans, prorogeable de deux ans (art. R. 593-28 C. env.). Plusieurs consultations ainsi qu’une enquête publique sont prévues (art. L. 593-8 et R. 593-16 et suivants C. env.).
Le décret d’autorisation de création peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par les tiers pendant deux ans à compter de sa publication au « Journal officiel » (art. R. 596-8 C. env.).
Autorisation de mise en service. Cette première et longue étape passée, une seconde autorisation est requise pour la mise en service de l’INB, c’est-à-dire la première mise en œuvre de substances radioactives dans l’installation. Elle est délivrée par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) [1], dont le délai d’instruction est d’un an, voire deux sur décision de ladite autorité lorsque la complexité du dossier le justifie ou si l’exploitant le demande (art. L. 593-11 et R. 593-36 C. env.).
Cette autorisation peut également être contestée dans un délai de deux ans à compter de sa publication ou de son affichage, étant précisé que ce délai peut être prolongé de deux ans suivant la mise en service de l’installation (art. R. 596-8 C. env.). Et tout naturellement, le fonctionnement de l’INB - assujetti à des prescriptions précises et à l’obligation de l’exploitant de procéder périodiquement au réexamen de son installation - peut faire l’objet de suspensions à tout moment (art. L. 593-18 et L. 593-21 C. env.).
Autres autorisations. En parallèle, l’exploitant d’un SMR devra obtenir un permis de construire au titre de la législation sur l’urbanisme, et le cas échéant, une autorisation de détention de matières nucléaires au titre du Code de la défense, une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre du Code de l’énergie, ainsi que les autres autorisations requises au titre du Code de l’environnement (dérogation espèces protégées, autorisation loi sur l’eau, etc.).
Ce processus décisionnel se justifie pour des projets de grande envergure menés dans un temps long, dont l’examen nécessite une importante instruction avant leur mise en service. Les enjeux des SMR diffèrent considérablement : après examen et validation de la technologie, l’objectif de la conception standardisée est de permettre un déploiement relativement rapide sur les différents sites, tout en assurant la prise en compte des impératifs de sécurité nucléaire.
En l’état, l’inadaptation de ce régime spécial et la complexité administrative du régime des autorisations administratives requises, ajoutées au délai de recours, entrave à l’évidence le développement de cette technologie.
La principale difficulté pour les investisseurs réside en effet dans la difficulté d’obtenir dans un délai adapté et maîtrisé des autorisations exécutables avec un degré acceptable de sécurité juridique. Comme c’est classique en la matière, les investisseurs n’acceptent de financer les projets qu’après obtention des autorisations administratives définitives, c’est-à-dire purgées de tout recours. Mais, puisqu’un seul recours suffit à paralyser le projet, les délais cumulés d’instruction, de recours et de jugement s’avèrent incompatibles avec les plans de financement.
Quelques pistes de réforme envisageables
Il en résulte la nécessité de créer, dans le respect impératif des enjeux de sécurité, un régime dédié, adapté aux spécificités de cette nouvelle filière de production d’énergie destinée à intégrer le mix énergétique français. Quelques mesures peuvent raisonnablement s’envisager.
Créer une « autorisation SMR » unique. Les modalités d’instruction des deux autorisations (création et mise en service) pourraient être simplifiées en vue d’abaisser leur durée. Une approche pourrait consister à regrouper l’instruction des autorisations préalables nécessaires à la réalisation de l’opération (autorisation de création INB, autorisation d’urbanisme et, le cas échéant, autorisation de raccordement, dérogation espèces protégées, loi sur l’eau, etc.), au sein d’une procédure administrative commune.
Pour ce faire, la mise en œuvre d’une procédure de guichet unique pourrait s’avérer pertinente. Un dossier de demande unique serait alors déposé auprès d’une seule autorité (par exemple le préfet de région), charge à elle de coordonner l’instruction auprès des différents services de l’Etat concernés, afin que soit délivrée une « autorisation SMR » unique incorporant les diverses autorisations requises.
Diminuer les délais de recours… Une autre piste possible se-rait d’abaisser drastiquement les délais de recours actuellement prévus pour les INB. Il est vrai que ce délai était initialement justifié par « les dangers que le fonctionnement de l’installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l’environnement » (art. R. 596-8 C. env.).
Mais comme on l’a vu, la longueur très inhabituelle des délais apparaît disproportionnée compte tenu de la technologie et des caractéristiques des SMR.
… et de jugement. Les délais de jugement contre ces autorisations constituent également un obstacle significatif. Une solution serait de confier la compétence de premier ressort aux cours administratives d’appel (sur le modèle des éoliennes terrestres), voire au Conseil d’Etat (sur le modèle des éoliennes off-shore) et de prévoir un délai de jugement restreint.
Réformer le dispositif des capacités techniques et financières. Une autre problématique, dont les conséquences ne sont pas moindres, réside dans le régime des provisions à constituer par les opérateurs et les propriétaires du terrain sur lequel l’installation a vocation à s’implanter. En effet, le Code de l’environnement impose au porteur de projet de constituer dès l’autorisation de création des provisions sécurisées correspondant aux « charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges de fermeture, d’entretien et de surveillance » (art. L. 594-1 et s. C. env.) et, plus généralement, de disposer « des ressources techniques, financières et humaines » pour maîtriser les risques et inconvénients que les installations peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, la protection de la nature et de l’environnement (art. L. 593-6 C. env.) C’est pourquoi l’autorisation de création est accordée en tenant compte des « capacités techniques et financières de l’exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts » (art. L. 593-7 C. env.). Or, compte tenu de l’absence de caractère définitif des autorisations, il sera souvent impossible de justifier de capacités financières suffisantes sans financements extérieurs, lesquels sont, comme on l’a vu, assujettis au caractère définitif des autorisations…
Une fois l’autorisation obtenue et en cas de défaillance de l’exploitant, ces obligations échouent légalement au propriétaire de l’installation ou du terrain d’assiette, ce qui lui impose de constituer des garanties techniques et financières importantes, qu’il n’est pas nécessairement en mesure d’apporter.
A cet égard, deux ajustements mériteraient d’être étudiés : - d’une part, en s’inspirant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), il conviendrait de permettre qu’au stade de l’autorisation de création, le pétitionnaire puisse faire valoir les capacités techniques et financières qu’il « entend mettre en œuvre », à charge pour lui de les « établir au plus tard à la mise en service de l’installation » (art. L. 181-27 et D. 181-15-2 C. env.) ; - d’autre part, il pourrait être judicieux de prévoir un régime exonératoire de responsabilité pour les propriétaires de terrain, ou a minima, de limiter leur responsabilité pour leur permettre la constitution de garanties économiquement raisonnables.
D’autres freins existent au déploiement des SMR en France, notamment en matière de fiscalité, de responsabilité, d’évaluation environnementale, d’accès aux dispositifs de soutien étatique, de gestion des matières et des déchets… Jusqu’à il y a peu, une évolution de la réglementation était annoncée pour la fin de l’année 2025. Reste à voir si elle aura bien lieu, et avec l’ampleur attendue et nécessaire pour les porteurs de projet.
(1) L’ASNR est issue de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, qui a fusionné l’Agence de sûreté nucléaire (ASN) avec l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
Ce qu'il faut retenir
- Les « small modular reactors » (SMR) présentent de nombreux avantages au regard notamment du développement rapide des centres de données.
- L'Etat soutient activement le déploiement de cette technologie mais le cadre juridique actuel des installations nucléaires de base (INB) auquel les SMR sont soumis, représente un frein important.
- Plusieurs pistes de réforme pourraient être envisagées comme la création d'une autorisation unique qui permettrait de réduire le délai d'instruction des dossiers.
- La réduction des délais de recours - actuellement de deux ans - et de jugement pourrait également être étudiée.
- Le dispositif des capacités techniques et financières que l'exploitant doit constituer dans son dossier pourrait être assoupli et harmonisé avec le régime des installations classées pour la protection de l'environnement.