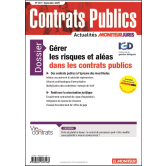C’est un bouleversement majeur qui s’annonce. L’article 5 du projet de loi de simplification de la vie économique (SVE), présenté le 24 avril dernier à Bercy, vise à faire de tous les contrats relevant du Code de la commande publique (CCP) des contrats administratifs. « Les marchés publics et les concessions peuvent être soit des contrats administratifs, soit des contrats de droit privé », rappelle Olivier Guézou, professeur de droit public à l’université Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris Saclay. Une qualification dont va dépendre le juge compétent : si le contrat est administratif, il relève de la juridiction administrative, s’il est de droit privé, il est du ressort du juge judiciaire.
Aujourd’hui, l’article L. 6 du CCP prévoit que s’ils sont conclus par des personnes de droit public, les contrats de la commande publique sont administratifs. Si cette disposition permet d’englober la majorité des marchés publics et des concessions, certains restent toujours des contrats de droit privé. Ce sont ceux passés par les entreprises privées soumises au CCP comme la plupart des entreprises publiques locales, les sociétés anonymes d’HLM ou encore certaines entités adjudicatrices (comme RTE, EDF ou La Poste).
Simplifier le contentieux
L’enjeu de la réforme, selon le gouvernement, est de mettre fin aux difficultés en matière de contentieux posées par cette dualité. Les recours en matière de commande publique devant le juge judiciaire seraient ainsi en moyenne plus longs que devant le juge administratif. Surtout, la détermination du juge compétent serait parfois délicate, à la fois pour les acheteurs et pour les opérateurs. En 2022, « 17 % des affaires traitées par le Tribunal des conflits ont concerné la matière contractuelle », peut-on lire dans l’étude d’impact du projet de loi.
Un argument qui ne convainc pas la Fédération des entreprises publiques locales (FedEPL) et la Fédération des entreprises sociales pour l’habitat (FESH), dont les structures adhérentes sont directement touchées par la mesure. « Ce ne sont pas nos contrats qui finissent devant le Tribunal des conflits », font-elles valoir, notant qu’en pratique la détermination de la juridiction compétente n’est pas compliquée, celle-ci étant obligatoirement indiquée dans la procédure de passation.
Harmoniser la jurisprudence
Pour Olivier Guézou, faciliter l’identification du juge à saisir n’est pas non plus l’argument décisif en faveur de l’unification contentieuse. « Si elle est bienvenue, c’est davantage dans la prévisibilité du contenu de la règle et dans la maîtrise de ses conséquences ». Car des différences existent entre les deux ordres de juridiction. Illustration la plus notable : la création par le juge administratif du recours « Tarn-et-Garonne », ouvert sous conditions à tous tiers pour la contester la validité d’un contrat administratif, sans qu’il n’existe de faculté similaire devant le juge judiciaire. « Il est vrai que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 2 octobre 2020, a indiqué que cette différence n'est pas inconstitutionnelle, note l’universitaire. Mais si cette possibilité était harmonisée pour tous les contrats de la commande publique, la Constitution n’en serait pas moins respectée et le principe d’efficacité des recours renforcé. »
C’est l’application des CCAG, le régime et l’économie de la réception, les avances, les avenants, les pénalités, etc. qui se trouvent frappés par cette fausse bonne idée d’unifier le contentieux.
— La FedEPL et la FESH
Des règles d'exécution plus souples
La FedEPL et la FESH tiennent aux particularités qui caractérisent les contrats de la commande publique de droit privé, qui « diffèrent significativement des contrats administratifs dès lors que viennent s’appliquer des normes issues du Code civil ou encore du Code de procédure civile ainsi que des règles jurisprudentielles spécifiques édictées par le juge judiciaire ».
Si Bercy met l’accent sur les conséquences de la mesure sur le contentieux, ses effets les plus notables semblent plutôt à chercher du côté de l’exécution des contrats. « Il s’avère que de nombreux pans de l’exécution des marchés publics des EPL et des ESH risquent d’être fortement bouleversés, analysent les deux fédérations. C’est l’application des CCAG, le régime et l’économie de la réception, les avances, les avenants, les pénalités et bien d’autres éléments juridiques qui se trouvent frappés par cette fausse bonne idée d’unifier le contentieux, sans que cela n’ait été pleinement mesuré. »
Régime exorbitant du droit commun
En outre, qui dit contrat administratif dit prérogatives de puissance publique. Lesquelles offrent notamment à l’acheteur la possibilité de modifier ou de résilier unilatéralement le contrat. « Le véritable apport de la mesure, à mon sens, est de remettre les notions de service public et d’intérêt général au cœur de l’identité des contrats de la commande publique conclus par des personnes privés, estime Lila Benchikh, chef de pôle juridique à RTE, société anonyme qui a la qualité d’entité adjudicatrice et est soumise à ce titre au CCP. C’est la reconnaissance que derrière ces contrats il y a le service public et qu’en dernier ressort l’acheteur, public ou privé, doit avoir les moyens d’assurer sa continuité et son efficacité. » Une consécration qui peut paraître légitime, tant les acheteurs privés opèrent dans des secteurs stratégiques, comme l’énergie ou le logement.
Des régimes qui tendent à se rapprocher
Secteurs qui traversent aujourd’hui des tensions qui pourraient être exacerbées par le déséquilibre engendré par ces pouvoirs exorbitants, selon la FedEPL et la FESH. « Certains de nos adhérents estiment que cela impactera l’attractivité de leurs marchés, déjà rendue compliquée pour certains achats de produits spécifiques notamment dans le domaine des transitions novatrices. »
Pour Lila Benchikh, la réforme ne devrait pas déstabiliser profondément les acteurs. « Certes, les acheteurs privés ont des pratiques plus consensuelles que les acheteurs publics, reconnaît la juriste. Mais même si le contrat administratif est en principe moins équilibré entre les parties qu’un contrat de droit privé, il y a tout de même beaucoup de similitudes : par exemple le régime de l’imprévision existe dans les deux cas, la possibilité de résiliation unilatérale peut être prévue dans un contrat privé, et les garanties de construction sont les mêmes. » De plus « les règles applicables aux contrats privés de la commande publique s’inspirent fréquemment de celles de leurs homologues administratifs », observe Olivier Guézou, qui cite notamment les nombreuses ressemblances entre la norme Afnor NF P 03-001 et le CCAG travaux.
Le véritable apport est de remettre les notions de service public et d’intérêt général au cœur de l’identité des contrats de la commande publique conclus par des personnes privés.
— Lila Benchikh, cheffe de pôle juridique, RTE
Liberté contractuelle
La FedEPL et la FESH reprochent au gouvernement de les priver de leur liberté de choix, en les soumettant d'office au régime des contrats administratifs. « La question des pouvoirs exorbitants et des différences de jurisprudences entre les deux ordres de juridiction est également en suspens dans le projet de loi, ce n’est pas vraiment rassurant », ajoutent-elles. Accompagnées par Coop’HLM, l’Union sociale pour l’habitat (USH), le Syndicat professionnel des entreprises locales d’energies (ELE), le syndicat professionnel Gaz et territoires et l’Union nationale des entreprises locales d’électricité et de gaz (Uneleg), elles ont écrit le 5 mai au ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique pour dénoncer cette mesure qui « jette aux orties la souplesse, la liberté et l’efficacité pratique dans l’exécution des contrats contre un bloc de contentieux unique que personne n’avait demandé ». Ces organisations ont également porté plusieurs amendements, adoptés par la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner le projet de loi, pour supprimer son article 5. Les séances publiques sur le texte débutent le 3 juin.
« Le gouvernement a sans doute intérêt à faire de la pédagogie car si la mesure touche peu d’acteurs, ce sont de gros acheteurs qui sont concernés », conclut Lila Benchikh, qui rappelle que RTE est actuellement mobilisé sur de gros marchés publics de travaux pour le raccordement des parcs éoliens en mer. Les contrats passés par les EPL représentent 4,2 milliards d'euros par an et ceux des ESH, 11 milliards d'euros par an.